
Le Salon International de l’Agriculture 2025 a une fois de plus confirmé son rôle de rendez-vous incontournable pour les acteurs du monde agricole. Agriculteurs, élus, entreprises et citoyens s’y sont rencontrés, échangeant sur les défis et les perspectives d’un secteur en pleine mutation et permettant de faire découvrir un domaine peu visible de notre économie et de notre paysage médiatique, mais qui ne manque pas d’être actif, mobilisé, innovant et résilient.
Plusieurs tendances contrastent avec les prédictions pour le moins pessimistes d’Henri Mendras dans La fin des paysans (1967). Loin de la disparition annoncée de la “paysannerie”, les données récentes témoignent davantage d’une dynamique de transformation et de résilience, éloignée du modèle d’une agriculture quasi-exclusivement industrialisée et marchande décrit par Mendras dans son ouvrage.
Une agriculture toujours vivante et enracinée
Les exploitations agricoles françaises continuent de diminuer en nombre, passant de 490 000 en 2010 à 390 000 en 2020. Cela n’est cependant pas significatif d’une disparition progressive de l’agriculture, car cette diminution s’accompagne d’une augmentation de la taille moyenne des exploitations, qui atteint 69 hectares en 2020, contre 55 hectares en 2010.
Le dernier recensement agricole réalisé par l’Agreste en 2020 souligne par ailleurs la forte présence de la vente en circuits courts et des initiatives locales de distribution, illustrant un mouvement de relocalisation de la production et de la consommation agricoles (hors produits carnés et viticoles).
L’agriculture française en mutation : des chiffres récents pour relativiser les croyances
Plusieurs tendances fortes se dessinent dans le monde agricole français :
- « Les métiers agricoles n’attirent pas/plus » : En 2022, 14 132 chefs d’exploitation agricole se sont installés, marquant une légère progression de 1,6 % par rapport à 2021.
- « Les jeunes ne sont pas attirés par le monde agricole » : 70,2 % des exploitants installés en 2022 avaient 40 ans ou moins.
- « Le maintien dans l’activité est faible » : 77 % des agriculteurs installés en 2016 étaient toujours en activité en 2022.
- « Le problème réside dans le fait que les agriculteurs ne vivent que de leur activité agricole » : La pluriactivité est en hausse, avec 39,2 % des nouveaux installés en 2022 exerçant une autre activité en parallèle de l’agriculture. Cette tendance reflète une adaptation aux réalités économiques et une volonté de sécuriser les revenus. Plutôt que la fin des paysans, une évolution des paysans ?
- « Le bio n’attire pas » : Transition agroécologique : alors que seulement 1,8 % des exploitations agricoles pratiquaient l’agriculture biologique en 2004, elles sont 14 % en 2022, avec une proportion plus élevée parmi les jeunes nouvellement installés (19 %).
- « Le secteur reste fermé aux femmes » : En 2022, près d’un tiers des exploitations ou entreprises agricoles étaient dirigées ou codirigées par au moins une femme (un chiffre stable depuis dix ans).
Plus qu’une fin des paysans, la France découvre un renouveau de ses paysans.
« Allez-vers » : une démarche à sens unique ?
Le Salon de l’Agriculture est aussi un moment de mobilisation fort pour le monde paysan, qui « monte à Paris » pour aller à la rencontre des décideurs et du grand public. Cette dynamique d’ »Allez-vers » pose toutefois la question de l’existence même de ce Salon.
La démarche d’ »Allez-vers » correspond, pour un acteur qu’il soit public ou privé, à l’initiative d’entamer une démarche proactive pour aller à la rencontre de certains publics qui n’ont pas l’élan naturel de venir vers lui.
Si les élus, les citoyens et les entreprises se montrent réceptifs lors du Salon, leur engagement envers le monde paysan au quotidien semble plus contrasté. Les tensions régulières sur les politiques agricoles, les difficultés économiques et le manque de reconnaissance de la profession suggèrent qu’un véritable « Allez-vers » réciproque est encore à construire et à renforcer.
Le rôle des élus dans la relation avec le monde agricole
Les élus jouent un rôle clé dans la reconnaissance et l’accompagnement du monde agricole. Leur implication dans la mise en place de politiques agricoles adaptées, le soutien aux circuits courts et la facilitation de l’installation des nouveaux exploitants sont autant d’actions essentielles pour renforcer la résilience du secteur.
Toutefois, au-delà des décisions institutionnelles, les élus locaux concernés par ces sujets doivent adopter une posture proactive d’ »Allez-vers » : aller à la rencontre des agriculteurs sur leurs exploitations, comprendre leurs réalités et intégrer leurs attentes dans les orientations des politiques publiques. La difficulté réside dans la remontée de ces informations et la non-prise en compte des doléances par les institutions publiques concernées, ce qui conduit à des épisodes de blocages et de colère d’un monde agricole qui ne se sent ni écouté, ni soutenu.
Un monde agricole différent de l’image que l’on s’en fait ?
L’édition 2025 du Salon de l’Agriculture a confirmé que l’agriculture française ne correspond pas à l’image figée et pessimiste d’une paysannerie condamnée à disparaître. Au contraire, elle fait preuve d’une capacité d’adaptation et d’innovation remarquable.
Toutefois, l’interrogation sur la relation entre le monde agricole et les autres composantes de la société reste ouverte. Comment renforcer l’engagement des élus, des institutions et des citoyens envers l’agriculture ? Comment mieux intégrer les agriculteurs dans la prise de décision publique ?
Le dialogue, la compréhension des enjeux, la prise en compte des problématiques propres à nos territoires et ses acteurs sont cruciaux.
L’Institut des Décideurs Publics se tient à la disposition des élus et des administrations locales pour les accompagner dans l’identification et la mise en œuvre de solutions adaptées à leurs enjeux.
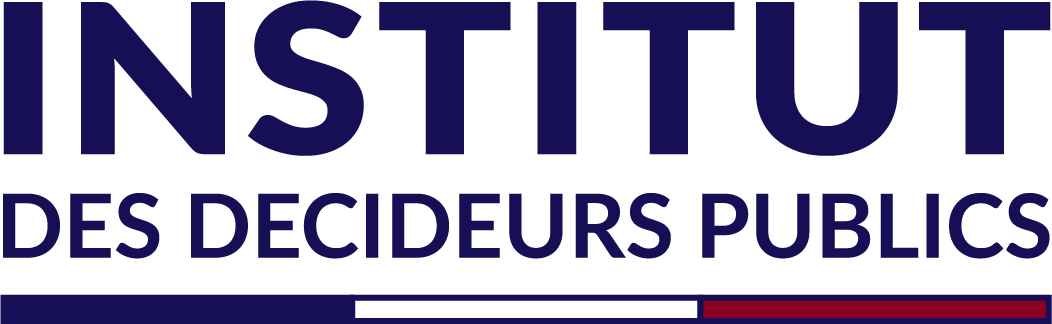
Excellente analyse. L’article est très intéressant.
Bravo pour la méthode qui positionne l’Institut autrement qu’un simple centre de formations mais bien également un espace de réflexion sur la place de l’élu dans l’écosystème et son adaptabilité aux changements sociétaires 🚀🚀🚀.
Merci Laurent de cet élogieux retour !
L’Institut des Décideurs Publics a en effet pour ambition d’offrir un espace de réflexion et de débat sur le rôle des élus et leur adaptation aux évolutions complexes et multiples des sujets de politiques publiques qu’ils ont à traiter au quotidien et sur le long cours.
Nous sommes convaincus que leur accompagnement passe autant par le développement des compétences que par la nécessité parfois du « pas de côté ».
Toute l’équipe est ravi que l’article vous ait intéressé !
Très intéressante analyse. Merci! Je suis une fervente adepte de cette pratique du « aller vers »! Il convient aussi de souligner les très fortes disparités économiques , entre les différents types de productions agricoles.
Ne serait il pas intéressant de réfléchir à la mise en place de dispositifs incitatifs, vis à vis des collectivités qui font le choix d’approvisionnements agricoles de proximité / structurants pour le territoire? Ce peut être à la fois intéressant d un point de vue économique, écologique … et gustatif 👍🏻
Merci Laurence pour votre retour et votre engagement en faveur du « aller vers » !
Nous savons qu’à Villepreux cette démarche est ancrée dans votre modus operandi!
Vous soulevez un point essentiel : les disparités économiques entre les différentes productions agricoles appellent des approches adaptées… et incitatives…
Mettre en avant, encourager et accompagner les collectivités vertueuses qui privilégient des approvisionnements locaux et structurants est un sujet clé pour apporter un souffle de transformation profond, tant pour le dynamisme territorial que pour les enjeux sociaux, écologiques et économiques qui touchent nos agriculteurs. Et nous nous accordons sur le fait que tout ne doit pas reposer que sur le seul effort des collectivités locales et territoriales.
L’Institut des Décideurs Publics œuvre justement à accompagner les élus dans ces réflexions stratégiques.
Merci pour votre contribution et votre bienveillance !