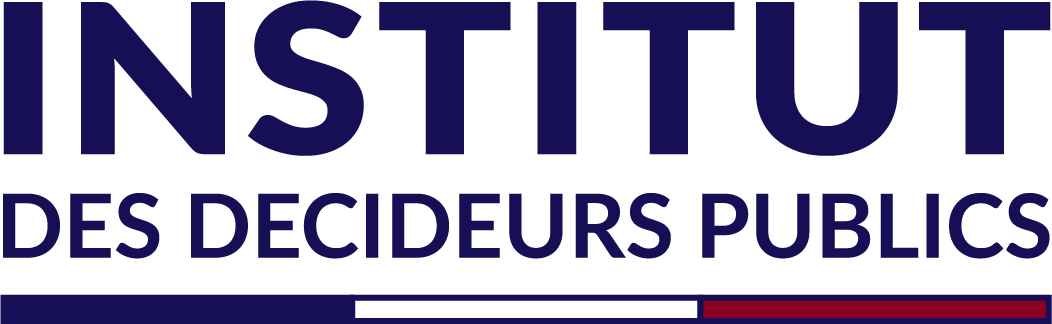Erigé en modèle pour son efficacité et sa capacité à s’adapter pendant la crise sanitaire, le couple Maire-Préfet serait-il de retour en grâce ?
En cette fin d’année parlementaire et à quelques jours de la trêve estivale, deux temps forts de la vie politique française semblent pouvoir donner corps à cette hypothèse.
Le statut de l’élu : un vieux serpent de Maires sur le point d’aboutir ?
Plus d’un an après son adoption par les sénateurs, l’Assemblée nationale a enfin voté la proposition
de loi sur le statut de l’élu local, initiée par la ministre Françoise GATEL, alors sénatrice.
Pour autant, comme un symbole, le nouvel intitulé de la proposition de loi adoptée en première lecture par
l’Assemblée ne laisse que peu de doute quant à la révision de l’ambition initiale du texte. A la baisse.
Exit le « statut de l’élu », au profit de « l’encouragement à faciliter et à sécuriser l’exercice du mandat
d’élu local ». En somme, la PPL ne crée pas, au sens juridique, de statut de l’élu, mais octroie des
droits à ces derniers.
Si le texte prévoit un certain nombre de mesures attendues par les élus telles que l’interprétation
plus précise et plus pragmatique des contours des conflits d’intérêts dits « publics-publics », où la
prise en compté du congé maternité, l’extension de la protection fonctionnelle – qui restera
néanmoins sur délibération pour les élus qui ne sont pas membres de l’exécutif -, l’aménagement
obligatoire du poste pour les élus en situation du handicap, ou encore la bonification d’un trimestre
par mandat aux élus ayant exercé en tant que maire, adjoint, président, vice-président ou conseiller
délégué (dans la limite de huit trimestres supplémentaires), le calcul retenu par les députés pour la
revalorisation des indemnités des fonctions de maire apparait beaucoup plus contesté.
En effet, sur ce sujet central qui devait, au-delà du montant, témoigner d’une meilleure
considération et d’une plus grande reconnaissance pour la fonction de maire, la proposition du Sénat
donnant lieu à une revalorisation de 10 % des indemnités versées au maire et aux adjoints au maire a
été écartée dans l’hémicycle du Palais Bourbon. Le choix d’une augmentation dégressive des
indemnités en fonction de la strate (population) ne fait pas que des heureux, notamment pour les
maires des communes de 3 500 à 20 000 habitants qui devront se contenter d’une revalorisation de 4
à 6%, soit entre 60 et 95 euros par mois. Les élus des communes de plus de 20 000 habitants sont
exclus du dispositif.
Ce statut de l’élu, qui en définitif n’en est pas vraiment un de l’avis des principaux concernés, laisse
un goût amer à nos édiles. Au regard des responsabilités occupées par les maires, de l’inflation des
contentieux pouvant entrainer une mise en cause personnelle, mais aussi compte tenu d’un climat
général dégradé débouchant sur cette mandature par un nombre record de démissions, un choc
d’accompagnement à l’engagement et d’attractivité de la mission était légitiment attendu. Il faudra
patienter jusqu’à septembre, pour voir le texte revenir au Sénat en seconde lecture. L’opportunité
d’éviter une occasion manquée ?
Réforme de l’Etat local : vers un « Super-Préfet » ?
C’est à Chartres, ville du Préfet Jean Moulin, que le Premier ministre a décidé de faire ses annonces
sur le devenir de l’Etat territorial devant le corps préfectoral. La maladie est identifiée, et pour le
coup pareillement diagnostiquée par les maires eux-mêmes : l’appareil de l’Etat et son action sont
fragmentés et dilués, source de panne d’efficacité. Le traitement est prescrit par François Bayrou :
recentrer la coordination de l’action publique autour du Préfet.
Les maires applaudissent. Si nombre d’entre eux appellent depuis les lois MAPTAM et NOTRe – qui ont
laissé quelques cicatrices – à un nouvel acte de décentralisation, non pas pour faire le grand soir mais
pour réaffirmer les libertés locales, ils n’en demeurent pas moins un soutien d’une
déconcentration efficiente, avec une organisation territoriale qui leur faciliterait la vie au
quotidien.
Pour cela, le meilleur ami du maire, c’est le Préfet. A condition qu’il soit seul et unique chef
orchestre, doté d’un pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des administrations et émanations locales
d’agences de l’Etat.
Le Premier ministre semble être du même avis : le préfet doit devenir une autorité de coordination
stratégique à part entière, passant de pilote sans levier sur les administrations spécialisées et
opérateurs nationaux à délégué territoriale unique avec une autorité managériale reconnue.
Dans le viseur, l’Education nationale, les directions départementales des Finances, les Agences régionales
de santé). Outre le rôle renforcé du Préfet dans les nominations à la tête de services déconcentrés,
ce dernier pourra suspendre les décisions des opérateurs nationaux ayant un impact sur son
territoire et exiger leur réexamen. Surtout, il disposera d’un regard renforcé sur les aides et subventions versées par l’ANCT, l’ADEME, l’ANAH ou encore les agences de l’eau.
Le renforcement du rôle du Préfet ne s’arrêtera pas là car il pourra user d’un pouvoir de dérogation
à toute norme réglementaire dans le champ de ses compétences, tant que cela concerne des
décisions individuelles.
Cette souplesse d’application supposait de sécuriser le représentant de l’Etat
dans le département. Cela a été rendu possible par le législateur en juin dernier. La carte
d’implantation des services publics de proximité et les éventuelles modifications de celle-ci
dépendant directement de l’autorité préfectorale.
Une disposition qui devrait rassurer les élus locaux qui voyaient parfois des services publics fermer unilatéralement, sans que le Préfet ait pu se prononcer. On pense alors en premier lieu à la carte scolaire, ou encore à l’offre de soins. Dans les territoires ruraux mais pas uniquement, cette évolution est accueillie positivement par les maires.
Sur la question de la santé, les zones d’intervention prioritaire (ZIP) et les zones d’action
complémentaire à la main des ARS devront demain, associer le Préfet. Trop de situations
incohérentes ont été constatées, excluant des communes de ZIP au motif de la présence d’une
maison médicale alors même que la pénurie médicale est avérée.
Le Gouvernement table sur deux décrets avant la fin de l’été pour mettre cette réforme en musique.
Il devra néanmoins attendre le retour du Conseil supérieur de la fonction publique d’Etat. Le PLF
2026 scellera quant à lui le sort des agences dont on an bien compris que certaines sont sur la
sellette.
Une question reste centrale : quelle place pour le Maire dans cet objectif de coordination et de
clarification de l’action de l’Etat dans les territoires ? Aucune codécision, aucune cogestion n’est
prévue entre le maire et le Préfet renforcé. Les associations d’élus demandent, à minima, une
consultation du maire pour les dossiers ayant une conséquence sur sa commune.
Statut de l’élu, réforme de l’Etat local, au bout du compte qui du Maire ou du Préfet sort le plus renforcé ?
Incontestablement le Préfet. Les avancées, timides, pour les élus locaux, ne seront pas de nature à
renforcer leurs prérogatives, ni même à garantir une sanctuarisation de leur périmètre d’action. Ils n’ont pas non plus d’assurance que cette réforme de l’Etat local n’ait pas pour agenda caché une
restructuration silencieuse ou un retrait progressif de l’Etat dans les territoires.
Une chose semble certaine, les maires auront tout intérêt à s’entendre avec leur Préfet. Un couple
déséquilibré, sans doute, mais un couple obligé de s’engager à une communauté de vie. Pour le
meilleur pour nos territoires et pour nos concitoyens, espérons-le !
Par Jean-Baptiste HAMONIC
Maire de Villepreux pour l’Institut des Décideurs Publics